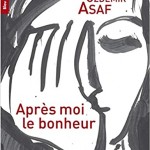Paroles aux traducteurs (5)
J’ai le plaisir de parler aujourd’hui de la collection Regards turcs chez l’Harmattan, dirigé par Sevgi Türker-Terlemez et Serpilekin Adeline Terlemez. Traductrices, écrivaines, très actives pour faire se rencontrer les cultures et faire découvrir la culture et la littérature turque, mère et fille ont déjà une longue liste à leur catalogue de collection. Sevgi Türker-Terlemez nous livre ici le détail de cette collection, de sa création à son organisation et nous fait partager sa passion de transmettre par delà les langues, de construire des ponts par delà les différences.
D’où est venue la nécessité d’une collection consacrée à la littérature turque ? Quelle littérature turque rentre dans le cadre de votre collection ?
Sevgi Türker-Terlemez: Résidant depuis plusieurs années à Paris et habitée par le désir de marcher vers l’autre, par ce désir de démontrer qu’on ne veut plus avancer seul, qu’on a besoin de l’autre dans toute sa différence, j’ai désiré, en tant qu’ancienne enseignante du FLE (Français Langue Étrangère) et écrivaine-traductrice, poursuivre à jouer mon rôle de passeur entre ma culture d’origine et ma culture d’adoption. J’ai désiré faire connaître la création poétique et littéraire – via la collection regard turc – avec un point de vue différent.
Résidant depuis plusieurs années à Paris et habitée par le désir de marcher vers l’autre, par ce désir de démontrer qu’on ne veut plus avancer seul, qu’on a besoin de l’autre dans toute sa différence, j’ai désiré, en tant qu’ancienne enseignante du FLE (Français Langue Étrangère) et écrivaine-traductrice, poursuivre à jouer mon rôle de passeur entre ma culture d’origine et ma culture d’adoption. J’ai désiré faire connaître la création poétique et littéraire – via la collection regard turc – avec un point de vue différent.
Guidée par cette émotion, – qui danse à travers mes langues, qui se transforme en re-création comme produit créatif entouré d’une aura de mystère, d’une beauté à demi voilée qu’on n’aperçoit plus qu’à travers un brouillard, – qui a excité en moi le désir irrésistible de créer une collection consacrée à la littérature turque dans les champs diversifiés tels que : roman, nouvelle, lettre, théâtre, essai, contes, textes poétiques.
Je trouve particulièrement bien réussi le logo de votre collection. Pourriez-vous brièvement l’expliquer pour les lecteurs qui n’en connaîtraient pas les symboles ?
S.T.T: Oui, je le trouve aussi… mais avant de donner une réponse à votre question, je me permettrais de commencer par une petite présentation de notre collection qui est dirigée par moi-même et ma fille Serpilekin Adeline Terlemez, écrivaine, poète, traductrice, docteur en esthétique, science et technologie des arts – spécialité théâtre de Samuel Beckett.
La collection regards turcs se veut un pont d’informations au sens où un ouvrage littéraire peut le faire. « Ce pont a pour ambition de transmettre ce qui nourrit, construit le lecteur, alimente sa réflexion, enrichit sa pensée. Il est ce quelque chose qui contribue à développer la pensée métisse et à montrer sa pertinence dans les champs diversifiés (roman, nouvelle, lettre, théâtre, essai) ; ceci afin de faire entendre la voix du pluriel, car il est indispensable, plus que jamais, d’élaborer l’inter-culturalité littéraire qui se manifeste tout au long de l’histoire humaine, ainsi que d’ouvrir un domaine info-littéraire et de faire jouer à la collection le jeu de la littérature universelle. […] »
Son logo a comme origine le pont du Bosphore ; le logo des Editions L’Harmattan et Şahmeran (Shahmeran ou Shahmaran, ou Şahmaran), une créature mythologique que l’on rencontre en Anatolie, en Orient. Ce mot viendrait du nom composé Şah-ı Meran, qui signifie shah des serpents. Dieu ou Déesse, ce serpent aux nombreux pouvoirs : créateur du Soleil et de la Lune, sauveur de l’humanité est aussi considéré comme signe de dualité linguistique et culturelle.
Vous travaillez à deux, mère et fille, quel est le rôle de chacune de vous dans la collection ?
S.T.T: Quand nous écrivons et traduisons en collaboration, il s’agit d’une écriture à quatre mains. Quant à la collection, il s’agit également d’une co-responsabilité.
Dans la présentation de votre collection, vous insistez sur le métissage de l’Anatolie et sur ces « fous » qui défient les pouvoirs en place par le biais de la littérature. Pourriez-vous nous en dire plus ?
S.T.T : Plusieurs civilisations voient le jour en Anatolie qui est considérée comme précurseur de la civilisation occidentale. C’est le lieu du dialogue, de la confrontation, de la tension, de l’harmonie dans lequel se nourrit la pensée métisse, linguistique, culturelle. Anatolie est la source « de mouvements et d’échanges » de créations, « d’un perpétuel devenir ». Cette source de créativité est parfois violente et destructrice. Elle se voit circonscrite dans des limites ; elle voit s’opposer la passion au blasement, l’invention à l’imitation, l’écart à la norme… La pensée humaine se voit révoltée… des écrivains, des artistes, des philosophes, des poètes coincés entre deux faces d’une même réalité, entre mythe et raison ne sont que des fous de la littérature, des arts.
Ces « Fous » se trouvent assez de force pour aller de l’avant dans la progression de la société afin d’explorer, d’assurer le terrain. Chargés de tout le poids des traditions, des compromis, ces « Fous » savent que la raison a besoin du mythe « pour rendre compte de certaines réalités qui la surpassent » alors que le mythe se sert de la raison pour se faire entendre et comprendre.
Que pensez-vous de la représentation de la littérature et plus largement de la culture turque en France ?
S.T.T: Contrairement à ce qu’on croit, la littérature turque est largement connue en France… je me contenterai de dire que c’est bien avant d’Orhan Pamuk, lauréat du prix Nobel de littérature en 2006.
Quant à la culture turque qui est imprégnée par plusieurs civilisations, je ne pourrai pas dire la même chose. On connait mal la singularité de la Turquie qui fait pont entre l’Europe et l’Asie. Fondée par Mustafa Kemal Atatürk sur les ruines de l’Empire ottoman vaincu, la Turquie est un État républicain et laïque.
Etes-vous en contact ou partenariat avec d’autres acteurs de la vie culturelle turque ?
S.T.T: Oui, évidemment… Je peux vous en donner le nom de quelques-uns :
Créé à Paris en 1984 par un groupe indépendant de Turcs et de Français, le Centre Culturel d’Anatolie (CCA) a pour ambition de faire mieux connaître la Turquie, sa langue et sa culture.
Créée à Nancy en 1989, l’Association A TA TURQUIE fait connaître la culture turque, à la fois au grand public et aux jeunes générations issues de l’immigration turque via ses publications et sa revue bilingue d’art et de littérature Oluşum/Genèse.
Quels sont vos prochains projets éditoriaux ?
S.T.T: Et si je vous disais : dessiner le bonheur de l’homme, la caisse du mouton et le destin du migrant…
Merci pour vos réponses !!!
S.T.T: Merci à vous…
Pour aller plus loin, voici le site de la collection, ici
Déjà parus dans la collection :
Théâtre interdit. Nouvelles dramatiques
Ali Poyrazoğlu
PARU LE 27/10/2021
Trois chambres, une caserne
roman-mémoires
Şule Türker
PARU LE 07/10/2021
La francophonie dans l’espace littéraire en Turquie
Ekrem Aksoy
PARU LE 11/06/2021
Si cela arrivait…
Tamer Levent
Traduit par Sevgi Türker-Terlemez et Serpilekin Adeline Terlemez
PARU LE 08/02/2021
La poésie turque ancienne. Essai poétique eu égard aux oeuvres de Yusuf de Balasagun et Mahmud de Kachgar
Vali Süleymanoğlu
PARU LE 07/12/2020
L’homme et la liberté. Essai philosophique
Sahin Yenisehirlioğlu
PARU LE 08/09/2020
Giordano Bruno. Pièce de théâtre musical en deux actes
Erhan Gökgücü
Traduit par Sevgi Türker-Terlemez et Serpilekin Adeline Terlemez
PARU LE 16/06/2020
Les gilets de sauvetage. Réflexions poétiques
Özdemir İnce
Traduit par Ferda Fidan
PARU LE 09/05/2020
Baudelaire. Essai empathique
Tuğrul İnal
Avec la préfacé de Bruno Cany
Traduit par Pierre Bastin et Özlem Kasap
PARU LE 22/01/2020
Scénario. Unique en son genre
Serpilekin Adeline Terlemez, Sevgi Türker-Terlemez
PARU LE 02/10/2019
Le Cercle sacré
Hasan Erkek
Avec la préface de Nurhan Karadağ
Traduit par Jean-Louis Mattéi
PARU LE 11/02/2019
À paraitre
L’autre parmi les autres, nouvelles
Sevgi Türker –Terlemez
Avec la préface de Philippe Tancelin
Salopette violette, pièce de théâtre
Ferhat Lüleci
Traduit par Sevgi Türker-Terlemez, Serpilekin Adeline Terlemez
Delphine, roman
Gül İlbay
Orhan Veli, essai
Tuğrul İnal
Le rire de l’opéra, réflexions poétiques
Özdemir İnce
Traduit par Ferda Fidan
Mon pays, mon pays, pièce de théâtre
Erhan Gökgücü
Traduit par Sevgi Türker-Terlemez, Serpilekin Adeline Terlemez
Le ciel est ailleurs, poésie
Yasna Samic
La parole aux traducteurs (4)
Pour finir cette année 2020 en beauté (malgré tout!), j’ai le plaisir de partager avec vous une interview avec Timour Muhidine, traducteur, enseignant-chercheur, qui nous a fait l’amitié d’échanger avec nous ses réflexions sur l’enseignement du turc, l’édition de la littérature turque et sa traduction. Timour Muhidine dirige la collection Lettres turques chez Actes sud, il a contribué à publier de nombreux classiques de la littérature turque et contribue également à faire connaître la littérature underground de Turquie.
« La traduction rapproche, enrichit l’expérience individuelle et rappelle le génie de la différence. »
1) Timour Muhidine, vous êtes, maître de conférences à l’INALCO. Que pensez-vous de la situation de l’enseignement du turc en France ?
La situation est mitigée : l’offre universitaire reste insuffisante car concentrée sur Paris(Inalco), Strasbourg (Université de Strasbourg) et Aix-en-Provence (où le turc est intégré dans un département Moyen-Orient). On devrait ouvrir des formations à Bordeaux, Rouen et Lyon car la demande y est forte et la population d’origine turque assez nombreuse dans ces régions… Pour les cours offerts au niveau du collège et lycée, on est entrés dans une période de turbulences puisque ni la partie turque, ni la partie française ne s’en charge. En ce sens, l’idée de nommer des enseignants diplômés d’universités françaises fait son chemin… le CAPES de turc pourrait d’ailleurs être réintroduit mais le chantier est tout juste ouvert.
Il semble que tout comme l’arabe, cette langue soit assimilée à une langue d’immigrés plutôt qu’à une langue étrangère au même titre que l’espagnol ou le russe. Pensez-vous que c’est vrai et si oui, voyez-vous des évolutions possibles ?
Oui, c’est le problème des langues liées à un grand groupe d’immigration en France : l’arabe continue de pâtir du même préjugé, l’image globale des pays arabes et de la Turquie n’étant pas très positive dans une partie du public. Peu de parents (en dehors des familles turques) pousseraient leur enfant à prendre le turc ou l’arabe s’il était offert en LV3. Bien entendu, cela concerne aussi les projets professionnels : si l’anglais ou l’espagnol paraissent indispensables, les langues orientales ont l’air beaucoup moins nécessaires. En réalité, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’une langue extra-européenne, en dehors de son utilisation pratique, vous ouvre l’esprit et favorise l’empathie. S’ouvrir à l’Autre, c’est aussi un des objectifs de l’éducation !
2) Vous êtes également auteur, traducteur et directeur de la collection Lettres turques chez Actes Sud. Vous avez été témoin du développement de l’édition depuis les années 2000, et plus précisément depuis la Saison de la Turquie en France organisée en 2010. Que pensez-vous de la situation éditoriale actuelle ? Tient-elle ses promesses du début?
Pour être exact, j’ai vraiment commencé à m’occuper de traduction de littérature turque autour de 1985… Il était question de lancer une revue en français sur la littérature turque : Anka a démarré en 1986 et a duré dix ans. Les rédacteurs et traducteurs avaient des projets différents mais tous désiraient faire connaître une littérature uniquement représentée par Yachar Kemal et Nâzım Hikmet alors qu’une nouvelle génération de prosateurs avait surgi dans l’après-1980. De plus Ataol Behramoğlu et Nedim Gürsel résidaient en France et pouvaient contribuer à ce projet… Ce qu’ils ont fait aussi en soutenant la jeune génération qui s’était mise à traduire : Ferda Fidan, Anne-Marie Toscan du Plantier, Stéphane Dudoignon et moi-même qui fut bombardé rédacteur-en-chef de la revue ! Mais c’est au tournant des années 2000, que les milieux éditoriaux français ont vraiment pris conscience des richesses de cette littérature, de la diversité des auteurs et que les fiches de lecture ont commencé à circuler…
Le sommet de cet intérêt a été atteint en 2009-10 pendant la Saison de la Turquie où le nombre de rencontres et de publications a véritablement « explosé ». Depuis dix ans, je trouve le rythme beaucoup moins soutenu : néanmoins, la collection que je dirige chez Actes Sud se maintient bien, elle a dépassé les 30 titres et au moins cinq ouvrages sont envisagés pour 2021-22. Mais il reste difficile de faire émerger de nouveaux noms… en 2018, j’ai préparé, avec Sylvain Cavaillès, un dossier spécial de la revue Siècle 21 sur l’Underground turc et kurde et je rêve de publier une anthologie des auteurs marginaux d’Istanbul, cette littérature Yeraltı qui caractérise les vingt dernières années. Ce ne sera sans doute pas chez Actes Sud…
3) Il existe l’Ecole de traduction littéraire à Paris créée en 2012 par le Centre National du Livre. Ce type d’école a-t-il contribué à améliorer la qualité de travail des traducteurs d’après vous ?
D’après les échos que j’en ai, l’Ecole de traduction littéraire du CNL aura conforté beaucoup de traducteurs dans leur vocation et a permis d’élargir leur réseau professionnel. Le fondateur – Olivier Manonni, lui-même grand traducteur d’allemand – a eu cette idée de mixer les langues et de proposer une formation trans-culturelle au sens large. On pourrait presque oublier de quelle langue on traduit, la traduction est une sorte de langue nouvelle. Pour ce qui est de la qualité des traductions, c’est difficile à dire : les ateliers de traduction sont – à mon avis – plus efficaces pour faire progresser les traducteurs. Mais dans ce travail, on progresse surtout « ite kaka » (en turc : « cahin-caha ») !
4) En tant que traducteur du turc, quelles raisons donneriez-vous à un(e) jeune de traduire de la littérature, de la poésie turque?
Pour quelqu’un qui a envie de donner des versions françaises de ses expériences de lecture, qui a envie d’enrichir le français d’une expérience d’étrangeté… On peut aussi envisager de participer activement aux échanges entre deux grandes cultures et choisir, par exemple, de traduire du domaine contemporain : chaque texte traduit et publié est une pierre apportée à l’édification d’une culture mondiale et dont on peut voir que les différences sont nombreuses mais n’empêchent pas de communiquer. Est-il utile de dire que la traduction rapproche, enrichit l’expérience individuelle et rappelle le génie de la différence.
5) Mahmoud Darwich dans la préface de son anthologie de poème en français chez Gallimard (La Terre nous est étroite et autres poèmes, 2000) dit que « le traducteur n’est pas un passeur du sens des mots mais l’auteur de leur trame de relations nouvelles ». À votre tour, comment définiriez-vous en quelques mots l’acte de traduire ?
L’acte de traduire, c’est avant tout une invention, une création. Cela n’a rien d’une copie servile pour restituer le contenu, une machine pourrait le faire… Bien sûr, le traducteur se doit d’être fidèle à l’esprit du texte, mais sa réussite sera d’autant plus grande qu’il crée du sens dans la langue d’arrivée tout en la « bousculant ». Cette force de création, si elle est réussie, inscrit le texte dans la langue d’arrivée comme un classique.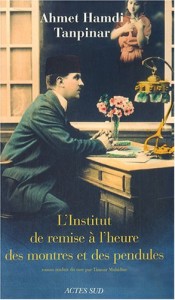
6) Quelle a été le travail de traduction qui vous a donné le plus de plaisir ou de mal ?
Les plaisirs de la traduction sont multiples mais c’est sans doute le roman de Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü qui m’en a le plus procuré. J’adore l’univers de cet auteur qui rêve les transformations de la Turquie à travers une langue très littéraire (riche de mots ottomans), une ironie souveraine et le goût de la nostalgie qui semble englober la pensée, l’architecture, la musique et la poésie d’un Empire perdu. Pour Tanpınar, c’est l’enfance (il est né en 1901) et le goût des choses enfuies à jamais qui orientent la littérature… Il m’a fallu bien du temps et des tâtonnements pour reconstituer cette tonalité en français : comme si une lumière d’automne baignait toute sa prose.
7) Enfin, quelles œuvres turques classiques ou contemporaines aimeriez-vous voir publier en français ?
Elles sont nombreuses : je regrette surtout que les traducteurs/traductrices de turc rechignent à travailler sur la poésie… J’ai traduit Nâzım Hikmet, Melih Cevdet Anday, Özdemir Ince, Bejan Matur et j’aimerais consacrer plus de temps à faire connaître certains noms du courant Ikinci Yeni. Mes favoris sont Edip Cansever et Metin Eloğlu…
Heureusement que Gaye Petek (elle a traduit Özdemir Asaf récemment) et toi-même Claire, n’oubliez pas ces voix essentielles qui disent une autre Turquie que les romanciers.
Source photo: ©Joseph Marando/CCAS
La parole aux traducteurs (3)
« Chaque traduction est une nouvelle gageure pour le traducteur»
Nous continuons les entretiens sur la traduction avec aujourd’hui le traducteur Ferda Fidan. C’est un des traducteurs du turc au français les plus brillants, il a traduit des classiques de la littérature turque tel que Ahmet Hamdi Tampınar, Yusuf Atılgan. Il a également traduit de la poésie, essentiellement les œuvres d’Özdemir İnce, il publie d’ailleurs ce mois-ci un de ses plus grands recueils, Les Gilets de Sauvetage, Réflexions poétiques, chez l’Harmattan, coll.Regard turcs. Dans cet entretien, Ferda Fidan nous dira comment il est devenu traducteur, il évoquera pour nous sa manière de traduire, les écueils à éviter et la particularité de la traduction de poésie.
Tout d’abord, nous avons été en pleine quarantaine, confinés face au virus. Le traducteur a l’habitude d’être isolé et seul dans son travail. Comment as-tu vécu ce confinement et quel regard portes-tu sur cette situation inédite ?
Il est vrai que le traducteur est par définition un travailleur solitaire. Évidemment, j’ai plus de temps libre maintenant pour me consacrer à mon travail mais aussi l’anxiété que génère cette situation et l’inquiétude concernant l’avenir ne favorisent pas la réflexion et la concentration. Je souhaite vivement que cette crise sanitaire nous fasse revenir à l’essentiel et nous fasse prendre conscience que les politiques libérales qui ont abouti à la mondialisation ne constituent pas un progrès pour les peuples mais pour les élites dirigeantes qui mettent leur vie au service du Veau d’Or. Voilà où nous a menés la destruction systématique de l’hôpital public gouverné par des comptables. Je suis du reste assez pessimiste pour la suite : dès la fin du confinement la loi du marché reprendra le dessus, la machine néo-libérale repartira de plus belle, et le citoyen ordinaire se retrouvera encore Gros-Jean comme devant.
Ferda, tu publies des traductions depuis 1984. Cela fait donc 36 ans. Comment as-tu commencé cette aventure ? Est-ce une personne ou une œuvre qui t’y a poussé ?
C’est au lycée que j’ai traduit mon premier texte, le Merdiven d’Ahmet Haşim. J’avais montré ma traduction à mon professeur de français qui l’avait trouvée plutôt réussie, tout en m’aidant à corriger quelques tournures. Trois années plus tard, c’est à l’université de Grenoble que j’ai commencé à traduire, plus sérieusement, des poèmes, des nouvelles et des extraits de romans, non seulement pour améliorer ma maîtrise de l’écrit, mais aussi pour tenter d’initier mes amis français à la littérature turque qui était alors presque totalement inconnue en France, en dehors de Yachar Kemal et de Nazım Hikmet. Un jour, j’ai envoyé deux textes d’Aziz Nesin au journal Le Monde qui publiait à l’époque, chaque semaine, une nouvelle intégrale dans le supplément du dimanche. C’est ainsi que fut publiée dans Le Monde ma traduction de la nouvelle d’Aziz Nesin intitulée Les Trois sentinelles (Üç nöbetçi). Pendant les vacances d’été qui ont suivi, j’ai rendu visite à Paris, dans les locaux du Monde, à Frédéric Gaussen qui m’a conseillé de traduire désormais des romans, me disant que la nouvelle était un genre peu prisée en France et que Le Monde lui-même allait bientôt arrêter d’en publier. (À cette époque je n’avais malheureusement aucun contact avec Aziz Nesin. C’est bien des années après que je devais le rencontrer, au cours d’un après-midi d’été à Istanbul. Les lecteurs faisaient la queue devant la petite table où il dédicaçait ses livres. Lorsque ce fut mon tour, je me suis présenté en lui disant que c’était moi qui avais traduit sa nouvelle publiée dans Le Monde en 1984. Il a levé sur moi des yeux étonnés en disant : « Ah ! c’était donc vous ! » Ce furent là les seuls mots que nous avons échangés.) 
C’est après cette première expérience que j’ai commencé à traduire des romans. Yaban et L’Hôtel de la Mère Patrie étaient des choix purement personnels. J’ai entrepris ces traductions sans aucun contrat, sans avoir la moindre certitude qu’elles seraient publiées un jour. À partir de la publication de L’Hôtel de la Mère Patrie en effet, ce sont les éditeurs ou les écrivains eux-mêmes qui ont commencé à me contacter pour me proposer divers projets…
Pourrais-tu nous parler de ta façon de traduire ? Comment procèdes-tu ?
Pour les livres que je n’ai pas déjà lus, je préfère aller droit au but et traduire au fur et à mesure que je découvre le texte. J’aime être à la fois le lecteur ordinaire et le traducteur parce que c’est ce cheminement linéaire qui me motive, qui me permet de rester disponible, ouvert à toutes les surprises. Mais, bien entendu, il ne s’agit là que d’un premier jet. Le plus ardu commence quand ce travail préliminaire est terminé. Il me faut alors tout reprendre mot par mot, phrase par phrase, pour y apporter de la densité, améliorer le rythme, rectifier les contresens ou les approximations que j’aurai inévitablement commis en cours de route, dans l’ignorance où je me trouvais de la suite du récit.
En commençant une traduction, je me demande quel serait l’équivalent en français de tel livre ou de tel auteur. Michel Tournier a commencé sa carrière en faisant des traductions de l’allemand. Il considère cet exercice comme une « école de vertu littéraire » et explique qu’il a traduit Erich Maria Remarque en songeant à Zola. Cette approche me convient parfaitement. En traduisant Yakup Kadri, par exemple, je pensais au Journal d’André Gide : Yaban est en effet un roman rédigé sous forme de journal et le narrateur est lui aussi un grand intellectuel pétri de culture universelle, dont le récit est traversé par d’abondantes références littéraires. J’ai donc traduit ce roman en relisant le Journal de Gide qui affectionne les expressions désuètes, un rien précieuses, tout comme le narrateur de Yaban, pour m’imprégner de son style, de ses phrases, de son vocabulaire, de ses tournures syntaxiques. J’ai par la suite appliqué la même méthode dans la plupart de mes autres traductions.
D’après toi, quels sont les points sur lesquels un traducteur doit faire particulièrement attention quand il traduit?
Il doit veiller à se détacher de l’attraction de la langue source pour ne plus raisonner que dans la langue d’arrivée. Il faut se demander constamment : comment le même auteur aurait-il écrit la même phrase, s’il avait été de langue française ?
Par exemple, il faut éviter de traduire littéralement des proverbes ou des expressions idiomatiques. Si un personnage dit : « Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır », on ne peut évidemment pas traduire ce dicton par « Un langage doux fait sortir le serpent de son trou », bien que la phrase soit assez belle et parfaitement compréhensible. Car cela donnerait à penser que le personnage emploie des expressions imagées de son cru un peu à la manière d’un poète. Or il s’agit ici d’un poncif, dicton populaire que tout le monde connaît. Il nous faut par conséquent chercher un équivalent : « Plus fait douceur que violence » pourrait donner la même idée en français. Ce que je dis là paraît un truisme, et pourtant on rencontre plus souvent qu’on ne pense ce genre d’erreurs, en particulier dans certaines traductions des romans de Yachar Kemal où les paysans de Çukurova s’expriment par moments non comme des paysans, mais comme des universitaires dotés d’un talent poétique.
Un autre écueil à éviter concerne les niveaux de langue. Ce qui paraît familier ou maladroit en turc doit le rester et ne peut pas trouver dans la traduction un équivalent courant ou soutenu (et vice-versa, bien entendu). Le mépris ou l’ignorance de cette règle de base a pour conséquence de transformer lourdement le style de l’auteur, tout en respectant rigoureusement le sens. Car on ne traduit pas uniquement le sens d’un texte mais aussi son arrière-fond, son contexte, son univers. Il paraît évident que deux phrases telles que : « Il a poireauté deux plombes pour des prunes » et « Il a attendu deux heures pour rien » veulent dire absolument la même chose et pourtant ne produisent absolument pas le même effet sur le lecteur ni ne donnent la même image du personnage qui prononce ces mots. Le traducteur ne peut s’autoriser à « améliorer » ce qui lui paraît maladroit ou trop familier car, dans le cas d’un véritable écrivain, on peut être sûr que c’est voulu. Malheureusement, certains éditeurs ont tendance à attribuer au travail du traducteur le caractère relâché de tels passages et exigent qu’il les « réécrive » : ce n’est donc plus de la traduction, mais du « rewriting ». Le devoir du traducteur consciencieux est de résister à cette tentation.
Tu as traduit de nombreux auteurs et notamment des auteurs classiques, dans le sens où ils sont passés dans le panthéon de la littérature turque, comme par exemple Yusuf Atılgan ou Aziz Nesin. Comment abordes-tu une œuvre classique ? Est-ce que ce travail de traduction demande une préparation particulière ?
Pas du tout : j’aborde les œuvres classiques exactement comme j’aborde les livres issus de la littérature contemporaine. D’ailleurs chaque auteur a son style propre et dans la mesure où elle pose de nouvelles difficultés, chaque traduction est une nouvelle gageure pour le traducteur. Je peux dire néanmoins que le livre le plus difficile que j’aie traduit était L’Hôtel de la Mère Patrie, non pas parce que c’est une œuvre classique, mais parce que Yusuf Atılgan s’y inscrit dans la tradition du courant de conscience à la manière de Faulkner, en utilisant des phrases extrêmement alambiquées, très longues, parfois sans aucune ponctuation, en procédant souvent par associations d’idées, qui plus est, tout à fait implicites.
Tu as traduit Enis Batur, grand auteur contemporain, poète et essayiste. Il vit à Istanbul, il me semble. Personnellement, j’aimerais beaucoup le rencontrer, il me paraît fascinant de culture. Pour ton travail de traduction l’as-tu contacté ? De manière plus générale, souhaites-tu rencontrer ou contacter l’auteur durant le processus de traduction ou bien préfères-tu te concentrer sur ta compréhension du texte sans les interventions ou les commentaires de l’auteur ?
En règle générale, je préfère bien entendu entrer en contact avec l’auteur, ne serait-ce que pour le plaisir de faire sa connaissance, pour pouvoir discuter avec lui de son œuvre, et lui poser des questions en cas de besoin, mais il se trouve que, pour les écrivains vivants que j’ai eu la chance de traduire, je n’en ai rencontré que trois : Enis Batur, Özdemir İnce et Selçuk Altun. Pour les autres, aucun contact n’a été établi ni pendant ni après le processus de traduction.
Enis Batur dirigeait les éditions Yapı Kredi quand il m’a contacté suite à la publication en France de L’Hôtel de la Mère Patrie. Comme il est francophone, et qu’il avait toujours été très proche de Yusuf Atılgan, sa veuve lui avait fait lire ma traduction qu’il avait beaucoup appréciée. Il a donc pensé à moi quand il a été question de traduire Acı Bilgi qui devait être publié en français sous le titre d’Amer savoir. Son style turbulent n’est pas toujours facile à transposer en français dans la mesure où il aime bousculer la syntaxe, comme s’il cherchait à s’en débarrasser (il ne faut pas oublier qu’il est aussi poète). J’ai par la suite traduit d’autres livres de lui en français et, à cette époque, nous nous rencontrions régulièrement à Paris ou à Istanbul. Je lui sais gré de m’avoir toujours témoigné une entière confiance et de n’être jamais intervenu dans mon travail. À la fois jovial et imposant, c’est effectivement un homme d’une érudition prodigieuse due à une curiosité universelle, toujours en éveil. Mais le temps file à toute allure et la distance ne favorise pas le contact : nous nous sommes perdus de vue depuis quelques années.
Tu es aussi traducteur de poésie. Tu as traduit Özdemir Ince, qui a notamment eu le prix Max Jacob dans ta traduction (Mani est vivant !, édition Al Manar, 2006). On dit souvent que la poésie, contrairement au roman, est impossible à traduire. Si la traduction consiste à dire l’identique, effectivement c’est impossible. Je pense, tu me diras si tu partages mon idée, que la traduction est l’art de faire passer un discours d’une langue à l’autre, d’un univers à un autre, avec les modifications imposées par la nature propre de la langue cible. Il s’agit donc plus d’équivalence. La traduction est un miroir et une fenêtre à la fois. La difficulté de la poésie, c’est qu’elle condense tout : rythme, musicalité, discours. Les traducteurs s’en arrachent souvent les cheveux ! Qu’en dis-tu ?
De toute façon, la traduction est une tâche a priori impossible quoique indispensable. Il est en effet impossible de rendre exactement dans le texte cible ce que dit le texte original. Si la traduction parfaite (du moins indiscutable) existait, on ne retraduirait pas régulièrement, au fil du temps, les chefs-d’oeuvre de la littérature étrangère. (combien de traductions de Hamlet en français depuis Voltaire ?)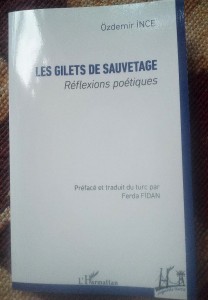
Ce qui est vrai du roman ou du théâtre l’est encore plus de la poésie : qui peut prétendre traduire parfaitement un poème dans ses composantes multiples (assonances, allitérations, rimes, rythme, harmonie…) ? Donc, tu as raison : il s’agit plus d’équivalence, voire – n’ayons pas peur des mots – d’adaptation. Et le texte poétique perd immanquablement beaucoup plus de sa valeur initiale au cours de la traduction que le texte romanesque ou dramatique. C’est précisément pour cette raison (pour ne prendre qu’un exemple parmi tant d’autres) que la poésie de Victor Hugo est beaucoup moins connue dans le monde anglo-saxon que ses romans, alors que le lecteur francophone l’apprécie autant comme poète que comme romancier.
Il ne faut pas oublier que le degré de difficulté d’une traduction dépend aussi de la distance ou de la proximité entre les deux langues en question : il est indéniable que traduire de l’italien en français pose nettement moins de problèmes que de traduire du turc en français, deux langues très différentes, qui n’ont rien de commun sur le plan grammatical. Par ailleurs, même dans ce cas précis, aucune difficulté n’est vraiment rédhibitoire, étant donné qu’il existe toujours une approche possible, mais il faut se résigner à l’idée que le résultat de ces efforts ne peut pas être parfait. On pourrait conclure en somme, en paraphrasant Hugo, que la traduction est l’asymptote du texte original : elle s’en approche toujours mais ne l’atteint jamais.
Pour finir, quel(le) auteur(e) aimerais-tu traduire aujourd’hui ?
Nezihe Meriç, Orhan Kemal, Erdal Öz (même s’il est très difficile aujourd’hui de faire publier des auteurs morts : il paraît que ce n’est pas bon pour le marketing ! ) et pour la littérature d’aujourd’hui, Latife Tekin, Pınar Kür, Kaan Arslanoğlu, Demir Özlü… et tant d’autres encore, peu ou pas traduits, qui mériteraient d’être mieux connus du lecteur francophone…
Merci de ta participation !
La parole aux traducteurs (2)
« Plus les textes sont traduits, plus ils se multiplient. » Ülker İnce
Pour continuer la série d’entretien avec des traducteurs, je vous invite dans cet article à découvrir la traductrice Ülker İnce. C’est une universitaire ayant notamment enseigné à la très réputée Université du Bosphore à Istanbul dans le département de traductologie. Egalement traductrice très active, exerçant essentiellement de l’anglais au turc, elle a traduit entre autres Oscar Wilde, Lawrence Durrell, F. Scott Fitzgerald. Sa traduction du Portrait de Dorian Gray a reçu le prix de la meilleure traduction de l’année 2014 par la Revue Livre Monde. Elle est l’épouse du poète Özdemir İnce.
J’ai réuni des extraits d’interviews qu’elle a données dans la presse afin de vous faire partager ses opinions sur la traduction et son expérience, que je trouve très intéressante.
Sur l’idée de la « bonne »traduction
« Shakespeare a été traduit et retraduit sans cesse. Chaque traduction est une interprétation. Le traductologue Hans Vermeer assimile le traducteur à un chef d’orchestre. J’aime beaucoup cette comparaison : « Le chef d’orchestre interprète un morceau de musique tout en restant fidèle avec minutie aux notes de musique » dit-il. Il en est ainsi pour le traducteur.
Pourquoi les gens font-ils confiance au texte source ? Même s’il ne l’a pas lu et qu’il ne le lira pas de sa vie, pourquoi le lecteur quand il lit un texte traduit peut-il déclarer que « ce n’est pas sa traduction » ?
Parce que les gens ont un préjugé en tête : un bon écrivain ne peut pas écrire en faisant un mauvais usage de la langue. Ils regardent la traduction. Si la langue est mal utilisée, maladroite, ils déclarent que cela ne retranscrit pas l’original. C’est le problème. Ce manque de confiance n’est pas dû à une connaissance du texte en langue original.»
Que traduit-on ? La nature polyphonique des textes
« Et puis, un texte ce n’est pas seulement des mots et des phrases. C’est une composition. Et cela n’est pas pris en compte par les traducteurs qui traduisent des langues éloignées vers la nôtre. Ils reproduisent les mots et les phrases, mais ils ne réalisent pas qu’ils aliènent la composition du texte original à cause de la syntaxe différente entre les deux langues et du changement de place des séquences opérés entre la version originale et la traduction.
Je pourrai apporter des dizaines d’exemples à ce sujet. Au-delà des mots et des phrases, un texte est formé par sa construction interne propre. Il faut refondre cet ordre, essayer de limiter les effets dus aux changements réalisés lors du passage d’une langue à l’autre. »
Ülker İnce donne un exemple concret :
« Quand vous traduisez de l’anglais en truc, vous commencez quasiment par la fin de la phrase anglaise. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans la traduction, l’ordre dans lequel vous donnez le sens se casse. Cela signifie que l’accent change. Les traducteurs pensent qu’ils ont effectué une bonne traduction, une traduction fidèle, quand ils ont traduit tous les mots, toutes les phrases. Ils ne réalisent pas qu’ils ont biaisé la composition du texte original. Le traducteur dévoile peut-être dès le début ce que l’écrivain voulait dire à retardement, alors cela fait disparaître l’intentionnalité de l’écrivain. Le contraire est aussi vrai : on met à la fin ce qui allait faciliter le sens de la lecture et cela rend le texte plus hermétique, plus laborieux que l’original. Un texte facile devenu difficilement compréhensible et parfois incompréhensible, c’est cela être fidèle à l’auteur ? C’est quoi ce travail ? »
Langue et vision du monde
« La langue n’est pas seulement un outil de communication, c’est aussi un outil pour appréhender le monde. Sans langue, pas de pensée possible. La langue reflète notre façon d’appréhender le monde et aussi notre vision du monde. C’est comme les deux côtés d’une même feuille, c’est inséparable. La traduction n’est pas seulement le passage de mots à d’autres, c’est aussi la transmission d’une vision du monde.
Je donne souvent cet exemple pour m’expliquer car il est très éloquent . Dans une nouvelle d’Hemingway, deux jeunes gens partent faire leur service militaire. On leur donne un uniforme, mais comme ils sont arrivés en dernier, on leur donne ce qui reste, les tailles qui restent. Ils enfilent leur uniforme, puis déclarent « nous sommes trop petits dans ces uniformes ». En anglais, ce n’est pas l’uniforme mais la personne qui n’est pas à la bonne taille. Ce n’est pas la faute de l’uniforme, mais des personnes. Si l’on raconte la même anecdote en turc, je suis certaine que l’auteur écrirait « L’uniforme est trop grand pour nous ». L’action est la même, mais un Anglais va la voir d’une telle façon alors que nous ne la voyons absolument pas ainsi. »
Ülker İnce nous donne ici une belle leçon sur la traduction, ses difficultés mais aussi sur le sel de ce travail. Car, traduire est toujours un défi, un pari. C’est une recherche constante pour le mot, la tournure, l’image juste. Cette action confronte le traducteur non seulement à un texte mais à un univers, à la fois personnel (celui de l’auteur) mais aussi culturel et géographique particulier. La réussite de ce pari sera toujours liée à une bonne connaissance de la langue source et de la langue cible et à une pratique de la traduction. En ce sens, le traducteur est un auteur, comme lui, plus il travaille, plus il se perfectionne et affine sa langue. Les algorithmes ne sont pas prêts de le remplacer !
Source: Journal T24, février 2019: https://t24.com.tr/k24/yazi/ulker-ince,2145/ Journal Gazete duvar, juin 2019 :https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/06/18/ulker-ince-cevirmen-yetismesinde-yayinevlerine-is-dusuyor/
La parole aux traducteurs (1)
Nous commençons cette année 2020 avec le premier article d’une série d’entretiens que je pense mener avec des traducteurs et traductrices du turc au français ou du français au turc. Il m’a semblé important de donner la parole à « ces travailleurs de l’ombre », sans qui le passage d’un texte au-delà des frontières de sa propre langue ne serait pas possible.
Pour ce premier entretien j’ai choisi le traducteur Yaşar Avunç qui a eu la gentillesse d’accéder à ma demande et de répondre à mes questions. Yaşar Avunç traduit depuis plus de 30 ans. Il est un personnage incontournable dans le monde de la traduction et a traduit non seulement beaucoup d’auteurs classiques français mais aussi des poètes turcs. Il garde intact sa passion pour la traduction et partage ici ses expériences exclusivement pour les lecteurs de la Revue Ayna, avec quelques conseils pour les traducteurs débutants.
Yaşar Avunç
- Monsieur Avunç, vous avez traduit des dizaines d’ouvrages du turc au français et du français au turc, pourriez-vous revenir sur vos débuts ? Comment vous êtes-vous pris de passion pour la traduction ?
Ma passion pour la traduction remonte aux années 40. Alors, élève au lycée, ayant traduit en turc un conte de Maupassant intitulé Mon oncle Jules je l’avais publié dans Notre journal rural. Comment cette passion est née chez moi ? Je ne saurais pas le dire exactement. Mais je la garde encore. Entre temps, de 1947 à 1951, j’ai étudié la philologie française et romane à l’université d’Istanbul et après des études supplémentaires de 1952 à 1954 à l’université de la Sarre fondée par les Français et les Sarrois (La Sarre était alors économiquement attachée à la France), je me suis lancé dans la banque pour des raisons financières à mon retour en Turquie. Mais pendant cette longue période de banque, je ne me suis jamais détaché de la littérature française. J’ai laissé tomber ma carrière de banquier en 1990 pour devenir un traducteur littéraire. Jusqu’à maintenant j’ai traduit plusieurs auteurs; je peux citer entre autres H. de Balzac, G. Flaubert, J.J. Rousseau, J. Anouilh, H. Bergson, J.Baudrillard, M. Leiris, J. Genet, M.Tournier, G. Bataille, A. de Saint-Exupéry,G. de Maupassant, É. Zola, Barbey d’Aurevilly.
- Vous êtes en particulier un passeur pour les poètes turcs qui veulent se faire connaître en France. Connaissiez-vous des poètes avant de les traduire ? Avez-vous des liens particuliers avec la poésie ?
Bien sûr, connaître le poète avant de le traduire serait un grand plaisir pour moi, mais l’occasion ne se présente pas toujours d’avoir ce plaisir et je me contente alors de son ouvrage. Parmi les poètes que j’ai connus avant de les traduire, je peux citer Attila İlhan, Ataol Behramoğlu, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Hilmi Yavuz, Özdemir İnce, İlhan Berk, Cevat Çapan, Sunay Akın et Tuğrul Tanyol. Je me suis intéressé à la poésie dès mes années de lycée sans jamais tâcher d’écrire des vers. J’ai lu avec plaisir presque la plupart des poètes turcs de l’époque contemporaine à partir de Nazım Hikmet. Pendant mes années d’université, j’ai eu l’occasion de m’initier à la poésie française. Ronsard, Villon, Lautréamont, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Prévert et surtout Baudelaire avec ses Fleurs du Mal furent mes poètes favoris.
- Quelles sont les difficultés particulières à la traduction de poésie turque à votre avis ?
La traduction de la poésie turque en français présente des difficultés autrement plus grandes, la langue turque étant fort différente de la langue française sur le plan phonétique, morphologique et syntaxique. Je peux dire que je tâche de dépasser ces difficultés en mettant en usage toutes mes connaissances établies de la langue cible et de la langue source.
- Pourriez-vous parler de votre méthode de travail ? Ce que vous faites en premier, les relectures par exemple ?
Je dois dire que je suis sélectif. Je ne tente pas de traduire chaque poème qui me tombe sous la main. Il faut que je me sente proche du texte original et que je l’aime. Alors commence mon travail de traducteur. Dans chaque poème il y a certes signification intelligible ou affective, images et musique, il peut y avoir aussi l’harmonie, la mélodie, le rythme, le lyrisme et parfois la rime ou la consonne et le mètre. D’abord, j’essaie de transposer à la langue cible les qualités de l’ouvrage original sans trahir l’art et la pensée du poète. Les relectures s’imposent pour les éventuelles corrections à apporter au texte.
-En dehors du sens, à quoi dans le poème, donnez-vous le plus d’importance ?A la musicalité, au rythme ? A la place des mots dans les vers ? etc.
Je peux dire qu’en dehors du sens je donne le plus d’importance à la fois à la musicalité et au rythme.
-Quels seraient vos conseils pour les jeunes traducteurs ?
Ils doivent avoir une excellente connaissance des deux langues et une très bonne culture générale. La traduction implique une affinité entre le traducteur et l’auteur et un grand effort de recherche et de patience en temps de traduction. Qu’ils n’oublient pas que l’objectif de tout traducteur est de réaliser une traduction fidèle et que les traductions comme les femmes, pour être parfaites, doivent être à la fois fidèles et belles.
- Enfin, cela fait plus de 30 ans que vous traduisez de manière générale. Sur cette période longue avez-vous noté des évolutions dans la manière d’écrire des poètes turcs ou bien dans les thèmes abordés ? Quel poète vous a marqué le plus dans votre travail ?
Sur cette période longue j’ai noté certaines évolutions dans la manière d’écrire des poètes turcs et dans les thèmes abordés. Je peux dire que la plupart de ces poètes ont choisi leur manière d’écrire sans se ranger dans un courant de poésie, en n’écartant presque aucun sujet, tout y étant matière à la poésie. Tuğrul Tanyol m’a vraiment marqué dans mon travail, j’ai traduit une soixantaine de ses poèmes réunis dans un recueil récemment édité chez L’Harmatttan sous le titre Une voix troublant le vent.